|
|
 |
|
|
Dès le
début du siècle, les maladies à prion ont été identifiées
par différents chercheurs.
Leurs évolutions ont été variées au cours du temps et les
transmissions des particules infectieuses protéiques ont elles-mêmes
augmenté et évolué.
En effet, des passages entre espèces ont été reconnus et des
cas de contamination intra-espèces ont aussi été observés
chez certaines peuplades pratiquant du cannibalisme traditionnel.
Récemment, la nécessité d’accroître la production de viande
bovine, afin de répondre aux exigences de la mondialisation,
au sein de l’Union Européenne a généré des pratiques à risque,
notamment par le biais de l’alimentation des cheptels avec
des farines d’origine animale.
Ces pratiques ont contribué à la transmission des maladies
à prion entre différentes espèces consommées par l’homme.
Quels sont les risques pour l’homme à long terme ?
Voilà
le contexte dans lequel les scientifiques, les autorités,
l’UE, les consommateurs et les exploitants agricoles s’efforcent
d’apporter des réponses à ce problème majeur en terme de sécurité
alimentaire.
|
 |
|
|
| Quelques
définitions |
Prion :
Particule infectieuse protéique, de nature et de mécanisme d’action
mal connus, qui serait l’agent des encéphalopathies spongiformes.
Encéphalopathie : Toute affection diffuse du cerveau;
Spongiforme : due à un prion pouvant atteindre l’homme
et les animaux (Maladies de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), de la vache
folle et la tremblante du mouton)
Kuru : Encéphalopathie due à un prion, qui affectait
certaines populations de Nouvelle-Guinée pratiquant le cannibalisme
(dont l’ingestion rituelle du cerveau des défunts par les femmes
de la tribu). |
 |
|
|
| Historique
de l'évolution des connaissances |
|
Voici
les quelques dates clés de l’évolution des connaissances concernant
les maladies à prion :
1920 : Creutzfeldt et Jakob décrivent une maladie
1936 : La transmissibilité de la tremblante du
mouton, du mouton à la chèvre est démontrée
1957 : Gajdusek et Zygas décrivent le Kuru (cannibalisme)
1959 : Le vétérinaire Hadlow signale des similitudes
entre le Kuru et la MCJ
La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) se décompose en quatre
groupes :
les MCJ sporadiques
les MCJ familiales
les MCJ iatrogènes
la nouvelle forme variante de la MCJ (nvMCJ) due à l’agent
bovin
Les maladies
à prion sont toutes caractérisées par une longue période d’incubation (2
ans chez les moutons, 5 ans chez les bovins) accompagnées
de troubles nerveux importants.
Chez l’homme, des études montrent que le temps d'incubation
de la maladie varie de 4 ans à plus de 40 ans.
Les américains
découvrent une encéphalopathie spongiforme transmissible chez
les visons n’ayant ingéré que des carcasses bovines avant
1985, ce qui les amène à suspecter la transmission de la maladie
de la vache vers le vison.
En outre, aux Etats-Unis, les chasseurs et les surveillants
des parcs nationaux s’inquiètent, d’une affection rencontrée
chez des cervidés sauvages (maladie du dépérissement chronique)
due également à un prion.
En 1985,
on découvre le premier cas d’E.S.B. en Grande-Bretagne.
En Mai 1988, 455 cas d'E.S.B. sont décelés, sur un cheptel
de 13 millions de bovins.
En 1990, on
constate le passage de la maladie chez le chat britannique.
Si les études montrent que le Kuru ou la tremblante du mouton
ne sont pas transmissibles au chat, il n’en est pas de même
pour la MCJ qui peut infecter expérimentalement le chat.
Cette affection naturelle du chat est dénommée encéphalopathie
spongiforme féline (ESF).
D’un autre côté, on sait que le lapin (et le chien ?) est
résistant aux ESST dans des conditions naturelles.
On parle alors de «barrière d’espèce».
Cependant, l’agent bovin franchit très facilement ces barrières.
|
 |
|
|
| Réactions
des Britanniques face à cette épidémie : |
|
En raison
de l’amélioration des connaissances scientifiques et des résultats
d’une enquête épidémiologique, les farines animales sont interdites
aux ruminants à partir de juillet 1988 au Royaueme-Uni.
Du fait de la durée de la période d’incubation de la maladie
bovine (5 années) la diminution du nombre de cas d’E.S.B.
n’apparaît qu’à partir de 1993.
C’est pourquoi les animaux nés entre 1986 et 1988 seront les
plus touchés, la diminution du nombre de cas d'E.S.B. n'apparaissant
qu'à partir de 1993.
L’utilisation des abats à risques spécifiés est interdite
à partir de novembre 1989 en Grande-Bretagne pour la chaîne
alimentaire humaine et de 1990 pour les aliments destinés
aux animaux.
Il faut
noter ici que les interdictions ont eu pour conséquence positive
de contribuer nettement à la diminution des cas d’E.S.B..
Lors de
son exposé, il faut souligner que Madame J. Brugère-Picoux
fait la distinction entre trois cas d'E.S.B. chez les bovins :
les cas non "N.A.I.F." (Né Après Interdiction Farines) :
on trouve sous cette appellation les cas d'E.S.B. apparus
avant l'interdiction des farines animales,
les cas "N.A.I.F.", qui correspondent aux cas apparus après
l'interdiction des farines,
les cas "super N.A.I.F." qui pourront être observés sur des
bovins nés après 1996.
En effet, à partir de cette année, un plan d'abattage sélectif
au Royaume-Uni est décidé par l'union européenne.
|
 |
|
|
| Quelle
a été la position des autorités dans cette affaire ? |
Les réactions
face à cette épidémie évolueront avec l’augmentation du nombre
de cas rencontrés :
De 1985 à 1990 : Absence de risque.
Milieu 1990 : Peut-être existe-t-il un risque ?
Car des symptômes de la nouvelle MCJ ont été décelés chez quelques
malades (dont deux jeunes).
Mars 1996 : Crise dite « de la vache folle » avec l’annonce
d’un risque pour l’homme (mesures décidées lors des accords
de Florence).
Octobre 1997 : On devient plus affirmatif, il s’agit de
l’agent bovin. |
 |
|
|
Quelle
est l’origine de la maladie,
quelles sont les barrières et
quels sont les moyens de prévention ? |
|
Tout d’abord,
il a été observé, par différents tests d’inoculation à des
souris, que les souches de l’E.S.B., de l’E.S.F. et la nv
M.C.J. sont identiques car les souris meurent après les mêmes
temps d’incubation.
De plus, les lésions cérabrales observées (profils lésionnels)
sont identiques.
En revanche, l’origine exacte de l’E.S.B. demeure très mal
connue.
Il peut s’agir soit d’une souche bovine, soit d’une mutation
ou encore d’un agent modifié de la tremblante du mouton.
On sait par ailleurs qu’il peut exister une compétition entre
les souches.
Il apparaît que chez certaines espèces la barrière existe
clairement (hamster), mais chez d’autres, comme le chien,
le risque d’une contamination par le prion bovin ne peut être
exclu.
Par ailleurs,
l’effet de la chaleur sur le prion (protéine) sera observé
partiellement à partir d’une température supérieure à 138°C.
Il est intéressant de relever que les risques de transmissions
de l’E.S.B. ont donc augmenté à partir du moment où pour des
raisons de rentabilité, les abattoirs britanniques ont abaissé
la température de combustion des carcasses.
La comparaison
des comportements en France et en Suisse révèle des éléments
intéressants.
La France
et la Suisse interdisent les farines en 1990 et le reste de
l’Europe en 1994.
En 1996, un plan d’abattage sélectif est décidé au niveau
de l’Union Européenne.
En mars
1999, la Suisse réagit efficacement face à cette épidémie
en mettant en place une épidémio-surveillance active.
Dès lors, on constate l’augmentation du nombre de cas d’E.S.B.
déclarés.
En effet, on passe de 14 cas de vaches folles en 1998 à 50
cas en 1999.
Il est tout à fait vraisemblable que le nombre d’E.S.B. non
déclarées dans le reste de l’Europe soit tout aussi important.
A cela, plusieurs raisons sont avancées :
La difficulté pour les éleveurs de repérer facilement les
premiers symptômes de la maladie (troubles du comportement),
La peur de déclarer des cas de vaches folles au sein de son
cheptel et de devoir subir la perte d’un troupeau,
Le peu de motivation à mettre en place un traçage efficace
à l’échelle nationale et européenne en raison des problèmes
de coût et des réactions à l’export.
Il est
donc nécessaire de mettre en place au sein de l’Union Européenne
un système de surveillance active sur le long terme, afin
de pouvoir suivre le plus efficacement possible l’évolution
des maladies à prion.
|
 |
|
|
| L’origine
des infections constatées |
lésions
cutanées,
voie orale par les aliments,
iatrogène : vaccin contaminé,
verticale : transmission maternelle,
On rencontre d'autres risques de contamination à l'abattoir :
par l'utilisation de pistolets à tige captive,
par les couteaux utilisés,
par le risque d’une contamination accidentelle lors de la fentes
de carcasses.
La transmission par le lait n’a jamais été démontrée. |
 |
|
|
| Les
symptômes rencontrés |
Dans le
cas de l'E.S.B., nous rencontrons des troubles du comportement
chez 90% des sujets atteints :
nervosité, hypersensibilité, appréhension.
Ce sont les premiers symptômes que seul l’éleveur peut détecter.
Des signes sensoriels font également leur apparition :
prurit (scrapie), léchage excessif.
Les tremblements, les grincements de dents, les postures anormales
et l’anomalie du trot complètent la liste des symptômes ci-dessus.
|
 |
|
|
| Conclusion |
|
Nous nous
trouvons actuellement face à des incertitudes concernant la
« disparition » de l’E.S.B. en Europe.
Faudra-t-il vivre à long terme avec l’éventualité constante,
avec un risque minimum acceptable de contamination par la
vache folle ?
Existe-t-il
donc des réservoirs d’E.S.B. en Europe qui maintiendront un
niveau d’infection possible, certes bas, mais toujours présent ?
Les animaux asymptomatiques peuvent-ils être porteurs de l'E.S.B. ?
Quelle est la contamination de l’environnement ?
Pour juger de l’efficacité des mesures décidées en 1996, il
faut attendre 2001, car la durée moyenne d’incubation de l’E.S.B.
est de 5 ans.
Mesures prises au Royaume-Uni Pour finir, on peut souligner
l'attitude adoptée par les anglais face à cette épidémie.
En effet, nous pouvons constater que les premières interdictions
sont mises en place en Grande-Bretagne que ce soit pour les
farines, les abats ou même pour le plan d'abattage collectif.
Certains pays tels que la France et la Suisse ont réagi avec
deux années de retard (1990), mais plus rapidement par rapport
à l'union européenne qui a attendu 6 ans avant d'interdire
les farines animales (1994).
Les britanniques prenaient des mesures sur leur territoire
mais l’exportation des farines anglaises contaminées a permis
l’infection des autres troupeaux européens, en particulier
le Portugal, l’Irlande, la Suisse et la France.
|
|
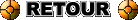
|
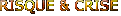
|
|