|
|
|
|
Par
Claude Regouby
et Sabrina CHARVET
|
Sabrina
CHARVET et Christian REGOUBY, de la société Concept
Consulting Group, nous ont témoigné leur expérience
concernant la gestion des crises par la communication.
Leur travail quotidien leur a notamment permis d’appréhender
les environnements auxquels ils étaient confrontés
afin d’analyser les mécanismes de la communication
de crise et les critères primordiaux à traiter
en terme de gestion.
Enfin cette démarche leur permet d’élaborer
aujourd’hui des plans de communication préventifs
que l’on traitera dans une dernière partie.
|
|
|
|
|
retour
en haut de page
|
| Les
caractéristiques générales de la communication
de crise |
| Dans
un phénomène de crise, il convient de distinguer
le volet " technique " de la crise de son
aspect médiatique : il faut les identifier de façon
différente. On observe diverses situations de crise au
quotidien (viols, problème de drogue,...) mais il est
important de repérer au niveau médiatique la sensibilité
des éléments qui constituent cette situation.
Cette sensibilité dépend largement du contexte
médiatique à un instant t dans un espace donné.
Un événement fera d’autant moins " parler
de lui " s’il survient à une période
où " l’actualité est riche ",
c’est-à-dire où notre environnement est
saturé en terme d’informations. L’incident
de la centrale nucléaire de Blayes en fin d’année
1999 en est d’ailleurs le parfait exemple. L’actualité
au moment de l’incident concernait les conséquences
du naufrage du pétrolier Erika et les récents
impacts de la tempête qui affectèrent l’ensemble
du pays. Cependant, dès que la " pression
médiatique " concernant ces deux événements
retomba, on observa une récupération médiatique
de l’événement qui revint au premier plan.
Il s’en suit un bouleversement du jeu des acteurs " sous
les feux des projecteurs ", chacun essayant de gérer
au mieux leur crise d’un point de vue médiatique :
Dominique Voynet, ministre de l’Environnement, ne s’est
elle pas plaint d’un manque d’information de la
part des décideurs en charge de la gestion de l’incident
de Blayes, alors qu’elle avait été, les
deux semaines précédentes, la cible des médias
suite à ses prises de position contestées concernant
les conséquences de la marée noire ?.
D’une manière générale, le contexte
est aujourd’hui porteur de crise. Les changements permanents
de dirigeants, les fusions/acquisitions accélérées
sont autant d’éléments révélateurs
de chocs qui se produisent au niveau des organisations :
choc culturel, problème d’identité, accélération
des sensibilités en sont les conséquences qui
provoquent une remise en cause et une perte de crédibilité
de ces organisations dans de nombreux domaines. On peut citer
par exemple :
- La
mise en doute du jugement des experts scientifiques du
domaine nucléaire depuis Tchernobyl, et notamment
la question de la dispersion du nuage radioactif en Europe.
- La
remise en cause des pouvoirs publiques dans l’affaire
du sang contaminé
- Les
problèmes éthiques liés aux expériences
de clonage
- Voire
même la mise en cause des professionnels de l’information
(faux reportages télévisés sur les
charniers roumains en 89)
Il en découle
un manque de transparence ressenti qui nourrit les craintes
de l’opinion publique en matière de sécurité
(en santé et environnement notamment) et qui est renforcée
par l’influence médiatique. Cette perte de repères
se manifeste et est accentuée par la déstabilisation
actuelle des institutions représentatives de la médiation
et de la régulation sociales, telles que la Police, la
Justice et les Politiques en particulier.
Ainsi
il est coutume de dire que, dorénavant, plus personne
n’est à l’abri d’une crise :
- elle
surgit de façon imprévisible
- les
causes sont multiples, de l’accident jusqu’aux
rumeurs
- le
citoyen est de plus en plus mature et a un regard de plus
en plus critique sur le fonctionnement de la société
- l’accès
a l’information est de plus en plus facile
Avec prudence,
on peut juger que nous ne sommes plus dans des démocraties
représentatives, où le vote constitue la sanction,
mais nous sommes désormais dans des démocraties
directes où le sondage, fondé, véhiculé
et utilisé par les médias notamment, mesure l’impopularité
des mesures prises par les autorités publiques.. La démobilisation
des premières se manifeste par la mobilisation autour
des secondes.
Dans ce climat, la communication de crise s’articule
autour de trois point majeurs :
- La
vitesse : l’information est diffusée
en temps réel
- La
détérioration de la qualité de la
communication : on mesure l’importance de la
charge émotionnelle de l’information qui " brouille "
les messages
-
L’attractivité des médias qui diffusent
les polémiques et nourrissent les conflits, dans
un espace-temps court, à un public parfois innocent.
La priorité,
en terme de communication de crise, concerne davantage la gestion
émotionnelle de l’événement, que son
traitement rationnel. Il faut répondre aux attentes en
terme :
d’implications
de l’organisation dans la gestion de l’événement,
qui doivent être réelles
d’explications :
pourquoi et comment l’organisation s’engage gérer
la crise en fonction des connaissances qu’elle a des
événements
L’étude
de la communication de crise employée par EDF et par
TOTAL-FINA lors des événements qui les ont affectés
en fin d’année 1999 peut nous permettre d’éclairer
notre point de vue :
La gestion
de communication par EDF a permis de maintenir son image auprès
des publics internes et externes : une entreprise ayant
le souci du service public. Ceci a pu être possible
grâce à de nombreux éléments :
une culture
interne de communication de crise, qui envisage notamment
des logiques différentes de travail et une organisation
hiérarchique modifiée en cas de crise
des simulations
régulières
de bonnes
connaissances des méthodes de travail et des relations
suivies avec des journalistes spécialisés
La gestion
de la communication par TOTAL-FINA a largement détériorée
l’image de l’entreprise et de son produit : aucune
prise en compte de la charge émotionnelle. Ceci se manifeste
par :
Le président,
T. DESMARETS décide de communiquer pour la première
fois seulement 3 semaines après le naufrage
Il reconnaît
alors ne pas avoir pris conscience de la catastrophe
Il adopte
un comportement de technocrate insensible au lieu d’exprimer
sa solidarité à l’égard des victimes
et sa responsabilité morale quant à l’événement
Il est
maladroit dans ses propos : son discours sur les fondements
de sa responsabilité juridique a notamment eu une résonance
négative pour la population
Suivent
des menaces de boycott des produits de la société,
des campagnes de dénigrement sur le net, des manifestations
de Green Peace et des détournements publicitaires
Il y avait
donc une nécessité de parade au niveau de la communication
institutionnelle de la société face aux effets
" boule de neige " des pétitions
sur le net. |
 |
|
retour
en haut de page
|
| Médias
et crises dans un contexte de société d’information |
| Aujourd’hui,
la société de consommation devient société
d’information.
La société de consommation est construite autour
des produits : les repères collectifs liés
aux produits sont fondamentaux pour les relations sociales
(situation des années 60 et 70).
Dans le cadre de la société d’information,
l’information est l’élément structurant
les relations les individus entre eux, et avec la société.
Elle devient un critère d’exclusion et d’appartenance
à un groupe.
 |
|
|
| Cadre
sociétal et individuel de la société
d’information |
Il est
important de se demander quelles sont les éléments
qui structurent la société d’information,
tant au point de vue de la société en elle-même,
qu’au niveau des individus.
 |
|
|
| Cadre
de la société |
L’accélération
vertigineuse de la production d’informations a pour conséquence
- D’amplifier
les changements permanents et de recomposer des perspectives
différentes : l’information régit
perpétuellement de nouvelles interactions entre
les individus de la société et la déstabilise
- D’accroître
la complexité étant donnée la masse
d’informations disponibles en temps réel
 |
|
|
| Cadre
des individus |
L’information
doit correspondre à la demande des individus et elle
a pour but :
De proposer
un sens (problématique d’identité)
D’accompagner
en permanence (problématique de proximité)
Pour cela,
la démarche doit permettre :
De rendre
lisible l’information
De donner
l’accès à l’information
De faciliter
l’utilisation de l’information
Après
avoir décrit l’environnement dans lequel l’information
se diffuse, il faut étudier ses caractéristiques :
 |
|
|
| Nature
de l’information |
 |
|
|
| Cadre
général de diffusion de l’information |
L’information
est ainsi devenue une marchandise et a une valeur en soi qui
dépend des supports de transmission. Ainsi le choix
de ces derniers doit tenir compte de 3 influences:
- Le
rôle de la presse et des mass media : champ
de concurrence (notamment entre les médias et les
NTCI)
- L’information
évolue dans un présent perpétuel :
dès que l’information est produite, elle devient
obsolète. On nomme ce phénomène la
dictature de l’instant.
- L’information
est diffusée en continu et en temps réel
et on ne vérifie plus les sources d’où
elle provient.
Dans ce contexte,
il convient d’identifier les grandes caractéristiques
de l’information
 |
|
|
| L’information
est un marché |
Elle devient
un produit de consommation courant et elle est " packagée "
pour être achetée : les médias sont
de moins en moins le quatrième pouvoir d’un point
de vue démocratique car ils se fondent dorénavant
dans une logique de pouvoir économique. Les grandes caractéristiques
de ce marché sont :
- l’information
est un marché structuré entre des organisations
publiques et privées qui choisissent de présenter
leurs informations en utilisant divers supports.
- l’information
est un produit avec ses marques, comme n’importe quel
produit de consommation. La teneur de l’information
est désormais fonction du client auquel elle s’adresse
- l’information
a une valeur en fonction de l’intérêt
qu’elle suscite
- l’information
est fabriquée par diverses sources
Les
3 sources principales d’information sont :
- les
agences de presse telles Reuter et l’AFP qui assurent
la transmission d’information au niveau mondial.
Aujourd’hui l’information qu’utilisent
les conférences de rédaction des principaux
quotidiens et hebdomadaires provient à 80% des
agences de presse, et à 20% de leurs journalistes
- CNN
qui diffuse de l’information dite globale en continu
- Internet :
Matt Drudge a notamment créé un site
sur les rumeurs suite à l’affaire Clinton-Legwinsky.
L’irruption de la rumeur affole la presse écrite
dont le but est de ne pas se laisser dépasser
par Internet. Ainsi, Drudge rivalise à armes
égales avec des journalistes, mais avec des
moyens largement moins importants. Le statut du journaliste
est ainsi remis en cause.
 |
|
|
| Information
spectacle et émotion |
L’information
diffusée doit répondre aux attentes de ce marché.
Pour cela, les deux grands types d’information qui sont
généralement utilisés sont l’information
spectacle et l ‘émotion dont on dresse ici
le portrait .
- Information spectacle
Elle est utilisée car il est nécessaire de faire
susciter un intérêt sur une information. La télévision
s’apparente ainsi à une machine à reproduire
des événements, et non plus à une machine
à produire de l’information.
- Information émotion
Le spectacle de l’événement a décontextualisé
l’information. C’est le principe de l’émotion
vérité qui prédomine et qui peut être
résumé ainsi : si l’émotion
est ressentie comme vraie lorsqu’on regarde la télévision,
l’information sera alors considérée comme
vraie. Il s’agit alors d’émouvoir, et non
plus d’informer.
La presse écrite a réagi face à la télévision
en explorant de nouveaux territoires d’information :
le journalisme de révélation qui concerne la
vie privée et les scandales et qui s’oppose au
traditionnel journalisme d’investigation.
 |
|
|
| Les
dérapages de l’information |
Ils sont
souvent la conséquence d’une recherche systématique
d’image. Il faut dire que dans la perception que nous avons,
nous mémorisons à 55% des images, 38% des sons
et 8% des mots.Les dérapages les plus remarqués
concernent :
- La
nécessite impérative de disperser l’image
conduit à en élaborer des fausses ou à
recourir aux archives de façon très approximative
- L’effet
paravent selon lequel une information en occulte une autre,
pour mieux la cacher
- Des
effets de censure démocratique (par opposition
à la censure autocratique). Partant du principe
que trop d’informations tue l’information, le
journaliste est asphyxié du fait de la surabondance
d’informations qu’il a traitées et il
noie l’information pour mieux la censurer
- Pour
réussir, les médias doivent être réducteurs
alors que les problèmes à traiter sont complexes.
- Un
souci déontologique : ce problème se
pose sous deux formes notamment
- Partant
du principe que l’information rapide fait l’audience,
celle-ci n’est plus vérifiée
- On
identifie un vide juridique quant à Internet :
le développement des technologies va plus vite
que la capacité des sociétés
à assimiler et réguler. De plus, plus
on produit de lois, moins on les applique
|
| 3. Communication
de crise, gestion à chaud |
Il
convient d’intégrer notre gestion de crise à
différents points de vue
 |
|
|
| La
gestion du temps |
Quand la
crise survient, la gestion du temps est le facteur essentiel
en terme de communication. Cette gestion du temps se manifeste
par diverses actions à mettre en place au sein de l’organisation :
- Réagir
sans attendre, décider quoi qu’il arrive
- Communiquer
rapidement.
Le
refus de communiquer peut être interprété
comme :
- Reconnaissance
de culpabilité
- Aveu
de désorganisation
- Tentation
de dissimulation
La
non-communication favorise :
- La
désorientation des employés et des partenaires
(clients, banquier,...etc.)
- La
curiosité des journalistes
- Le
développement des rumeurs
|
 |
|
|
| L’honnêteté
du discours et le souci de transparence |
L’honnêteté
du discours d’un point de vue intellectuel est un enjeu
majeur car il faut prendre conscience de diverses facteurs :
- Le
public n’est pas dupe et est plus mature qu’on
ne le croit
- Il
prend conscience que le risque 0 n’existe pas
- Il
ne faut plus avoir peur de parler clairement
- Il
faut assurer une prise en compte et une présence
immédiate auprès des victimes
- Il
faut expliquer les moyens déployés et la
méthode mise en place pour réguler la situation
En effet,
il convient aussi de garder à l’esprit que les victimes
se retournent de plus en plus contre les organisations responsables
des dommages, suivant un processus légaliste qui met
en cause la responsabilité de leurs dirigeants notamment.
 |
|
|
| Les cinq grands principes de la communication de crise |
Gestion du
temps et honnêteté du discours étant les
critères primordiaux à considérer, la démarche
de communication de crise s’appuie sur 5 grands principes :
- Jouer
la transparence
- Prendre
en compte et limiter l’émotion au profit d’explications
rationnels
- Considérer
les personnes internes à l’organisation comme
les premiers relais d’information : leur expliquer
et leur faire comprendre l’information
- centraliser
et canaliser les informations : garantir la cohérence
du discours, mettre en place une organisation militaire
- utiliser
un langage simple et accessible, adapté aux différentes
cibles
 |
|
|
| La gestion de la crise |
 |
|
|
| Gérer la crise en anticipant |
Tenant
compte de ces principes, le mieux est d’anticiper et
d’agir préalablement à la crise, notamment
en ce qui concerne :
- La
mise en place d’une véritable stratégie
de communication qui définit les finalités
et les valeurs à défendre, les politiques
et les orientations à suivre, les objectifs et
les échéances à atteindre, et qui
garantit la cohérence de la tactique mise en place
pour gérer la situation
- La
préparation par des exercices de simulation de
crise
- Les
relations régulières avec la presse qui
faciliteraient le dialogue dans la tempête :
tenir compte des exigences de leur activité et
leur faire comprendre le climat de vie de l’organisation
en interne.
- La
constitution d’une cellule de crise et répartition
des rôles pour organiser la communication en interne
et externe
D’un
autre côté, il ne faut pas se laisser surprendre
et éviter les erreurs qui peuvent être :
- Prendre
ou ne pas prendre la parole sans avoir mesuré l’amplitude
de la crise
- Attendre
trop longtemps pour communiquer et laisser le terrain
à d’autres plus ou moins biens intentionnés
- Trop
varier les porte-paroles et diluer l’information
- Confier
la responsabilité de la communication à
des personnes dont l’autorité est insuffisante
- Réagir
de façon polémique aux exagérations
de la presse
 |
|
|
| Pendant
les événements, identifier la crise à
partir d’une grille d’analyse et mettre en place
une démarche cohérente |
Il convient
alors d’analyser :
i) Les
faits : répondre aux questions
a) qui,
quand, comment et où ?
b) déterminer les éléments
factuels sûrs et vérifiés
c) quel type de crise ?
ii) Les
interprétations des faits : répondre
aux questions concernant :
a) la
dominante de la situation
b) les causes
c) les responsabilités
d) la prévisibilité des événements
e) la médiatisation actuelle de la
crise
f) le déroulement de la crise
g) les conséquences
h) les dommages futurs prévisibles
S’inspirant
de cette analyse, la démarche doit se dérouler
en plusieurs étapes, les tâches principales étant :
i) Activer une cellule de crise
ii) Identifier les publics cibles : les
opposants et les sympathisants, le caractère
passif et actif de leurs actions, leur logique d’intérêts,
leur logique d’influence
iii) Organiser des contacts rapidement
iv) Mettre en place des dispositifs d’information
avec différents publics
v) Formuler puis piloter les messages stratégiques
au fil des épisodes
a) communiquer
rapidement sur les faits en neutralisant les
rumeurs et en dépassant les rumeurs
b) communiquer avec des messages clairs
et un discours cohérent
c) adapter le contenu des messages
vi) Renforcer
la communication interne
 |
|
|
| Gestion
de l’après-crise Les
objectifs sont : |
- D’arrêter
la communication à temps
- D’établir
un retour d’expérience pour optimiser la communication
de crise de l’organisation
- De
revoir les plans de communication et envisager des actions
pour redonner confiance
- D’analyser
les leçons tirées de la gestion de crise
en ce qui concerne
- la
mise à nu des organisations et des individus
- les
obligations et les responsabilités impliquées
- la
cohérence, les explications fournies et la
prise en compte des intervenants (comprendre la réaction
du public et des journalistes, leur désarroi
et leur perception de la situation par exemple)
La crise
est donc un révélateur. |
 |
|
|
| Conclusion |
| Les
diverses acteurs attendent des responsables des prises de position.
Ces dernières doivent refléter les engagements
de l’organisation dans la gestion de la crise et sont d’autant
plus importantes que les enjeux économiques de telles
situations sont primordiaux. En effet la pérennité
de l’entreprise en dépend.
La démarche même de gestion de crise suppose
un savoir faire en terme de communication de crise pour garantir
la crédibilité et l’image de la société
auprès de ses personnels, ses clients et ses partenaires.
Elle repose avant tout sur un esprit critique de la part des
décideurs qui doivent être capables de décrypter
et d’assimiler les signaux avant-coureurs et les caractéristiques
de la situation de crise. Ce travail d’analyse doit permettre
aux responsables d’adapter et de rendre cohérent
et unanime leur discours en privilégiant la transparence
et une approche pédagogique face au déferlement
et à l’omniprésence des médias.
Dans ce contexte, la sensibilisation et la préparation
des organisations à ce type d’événements
doit être régulière et adaptée,
l’idéal étant d’anticiper et d’appréhender
les difficultés auxquelles la société
pourrait être confrontée. Cette démarche
signifie que les rôles et l’organisation de crise
doivent être préalablement définies et
de manière concrète, afin d’éviter
que la communication de crise n’entraîne une crise
de la communication pour l’organisation.
|
|
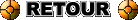
|
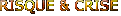
|
|