|
|
|
L'APPROCHE GLOBALE DE LA SECURITE
|
| Un commerçant de Kaboul, rapporte un quotidien important,
explique, tandis que les préparatifs d'une intervention
militaire américaine battent leur plein, qu'il n'a "
pas peur du tout ", n'ayant connu que la guerre depuis
vingt ans. Cette placidité illustre la différence
entre insécurité et sentiment d'insécurité
et ne saurait être mise au seul crédit d'une proverbiale
sagesse orientale.
Les deux spectaculaires évènements récents,
criminel à New-York, accidentel à Toulouse,
n'étaient pas nécessaires pour alimenter dans
la plupart des pays occidentaux un sentiment d'insécurité
qui croît depuis une décennie. Cette évolution,
qui a transformé la sécurité en enjeu
électoral majeur, pour la première fois depuis
longtemps, s'appuie certes sur des statistiques de la délinquance
elles-mêmes en augmentation, mais aussi sur d'autres
facteurs : instabilité économique et sociale,
où la crainte de lendemains précaires alimente
les angoisses, avancées technologiques rapides dont
la maîtrise est difficile et qui accentuent les clivages
sociaux, course à la productivité génératrice
de " dommages collatéraux ". La crise dite
de la vache folle en est un exemple particulièrement
significatif, qui conduisit une partie importante de la population
à s'abstenir longuement de consommer de la viande de
bœuf, alors que les risques encourus avaient été
maîtrisés rapidement.
Les dérèglements sociaux sont liés,
sans qu'on puisse clairement induire des relations de cause
à effet, à des évolutions sociales spectaculaires,
telles que l'éclatement du cadre familial traditionnel,
objet d'analyses nombreuses, l'urbanisation de l'écrasante
majorité de la population, qui développe l'anonymat
des individus. Bien des repères civiques ou éthiques
s'estompent, au point qu'on a vu prospérer depuis quelques
années le terme d' " incivilité ",
pour désigner les comportements contrevenant aux usages
.
Paradoxalement, le commerçant de Kaboul, bien plus
en danger que le citadin français, se sent davantage
en sécurité puisqu'il n'a pas d'autres repères
que le désordre. Le citadin français a constaté,
lui, pour peu qu'il ait passé trente ans, une détérioration
de la situation . Il réclame en conséquence
des initiatives de la part des institutions, mais il oublie
souvent que la sécurité est aussi le résultat
de comportements individuels et collectifs, et non un bien
ou plus exactement un service de consommation.
Aborder aujourd'hui la sécurité dépasse
les traditionnelles fonctions de police ( sécurité
intérieure) ou d'armée ( sécurité
extérieure ), même si celles-ci doivent conserver
un rôle éminent. Dans un monde devenant plus
ouvert, plus complexe et plus incertain, l' insécurité
s'amplifie et se diversifie. Face à cette évolution,
des initiatives multiples et judicieuses sont prises, souvent
dans l'urgence, pour renforcer la sécurité des
domaines les plus sensibles.
Pour autant, nos concitoyens ont le sentiment que les efforts
déployés, même s'ils sont dans certains
secteurs très efficaces, n'apportent pas de réponse
satisfaisante au besoin global de sécurité de
la société.
Partant de ce constat, la présente étude s'est
attachée, à travers l'analyse des risques, des
comportements, des organisations et des méthodes, à
rechercher les voies susceptibles d'améliorer l'appréhension
et le traitement des problèmes de sécurité
quel que soit le domaine où ils se manifestent. Elle
a, en conséquence, privilégié une approche
globale de la sécurité, qui a mis en relief
l'importance d'une culture de sécurité et les
conditions d'une prise en compte optimale du phénomène.
Elle en déduit, in fine, une série de recommandations
susceptibles de réduire sensiblement les insuffisances
actuelles.
- Le concept de Sécurité Globale
- La sécurité est à
considérer dans sa complexité
- La sécurité se définit
en opposition à l'insécurité
- La sécurité se définit
en fonctiond'un choix de société
- Mais la sécurité n'est
pas une fin
- Quand la sécurité n'est
plus globale (un exemple : la structuration
du territoire)
- La culture de sécurité
- L'initiation
- La formation
- L'information
- L'apprentissage
- La valorisation de l'image
- La prise en compte de la sécurité
- L'ETUDE
- L'anticipation
- L'expérience
- La hiérarchisation
- Les obstacles à surmonter
- LA DECISION et SA MISE EN OEUVRE
- Des objectifs, une stratégie,
des moyens
- Des principes d'actions
- L'évaluation des résultats
- Propositions
- La culture de sécurité
- Apprentissage de la sécurité
- Formation à la sécurité
- Valorisation de la sécurité
- L'amélioration de la prise en
compte de la sécurité
- La méthodologie : 3 phases
- L'organisation
- Les comportements
- Conclusion
- Annexe : les outils de la sécurité globale
|
| Le concept de Sécurité Globale |
|
| La sécurité couvre un large
éventail de domaines tels que l'ordre public, la
santé , la défense, l'environnement, les
transports… Elle peut concerner les personnes, les
biens, les espaces, les réseaux. |
| retour en haut de page |
 |
|
| La sécurité est à considérer dans sa complexité |
|
La difficulté à discerner
les tenants et les aboutissants, la diversité des
causes et des conséquences des situations d'insécurité
conduit trop souvent à limiter la réflexion
et le traitement de ces situations à des réponses
d'urgence à effets essentiellement immédiats
ou à la définition et à la mise en
place de dispositifs élaborés mais limités
à des secteurs relativement restreints ( industries
à risques, par exemple).
Ainsi, l'augmentation des effectifs de police décidée
dans un contexte de violence ne peut à elle seule
résoudre le problème de l'accroissement
de la délinquance, de même que l'on ne peut
résoudre celui de la violence à l'école
en imputant celle-ci à la seule désocialisation
des jeunes en difficulté.
Il paraît donc indispensable de recourir à
une approche plus approfondie des problèmes en
recherchant l'enchaînement des causes immédiates
et lointaines , les conséquences directes et indirectes,
les interactions, la dynamique des situations et le rôle
des acteurs concernés.
Cette analyse systémique et transversale fonde
le concept de sécurité globale. Elle repose
sur l'identification, c'est-à-dire la définition
des risques, des domaines concernés, des enjeux,
des conflits de rythme au sein des réseaux d' acteurs.
L'identification est déterminée par la culture
; le référentiel est construit par la formation,
l'apprentissage et les retours d'expériences.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| La sécurité se définit en opposition à l'insécurité |
|
L'inquiétude est due à l'imprécision
de la menace perçue. Dans nos sociétés,
il apparaît que le sentiment d'insécurité
naît de l'insuffisance d'identification des risques,
de la méconnaissance de leur probabilité
et de leur gravité, du schéma culturel de
représentation individuel et collectif, de la surabondance
d'informations et de la complexité croissante des
réseaux. Ce sentiment résulte de dysfonctionnements
de l'organisation de la collectivité et de la communication.
Lui-même peut susciter de l'insécurité.
La politique de sécurité s'élabore
à partir des risques d'insécurité
ressentis et pressentis. Elle participe à l'élaboration
de normes de sécurité exprimant les seuils
d'acceptabilité de risque ; ces normes sont spécifiques
à une société et à un moment
donnés.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| La sécurité se définit en fonction d'un choix de société |
|
Nous sommes tous, individuellement et collectivement,
acteurs de la sécurité ; nous participons
à la production de la chaîne de la sécurité.
Il suffit qu' un acteur soit défaillant pour que
la chaîne soit fragilisée. L'interdépendance
des parties d'une société indique que sa
sécurité doit être globale, et qu'en
retour la société doit être pensée
dans son unité.
Patrimoine de la collectivité, la sécurité
est un des axes majeurs des politiques en charge du bien
public, elle est étroitement liée à
notre choix de société, elle contribue à
l'intégration et à la reconnaissance des
individus.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Mais la sécurité n'est pas une fin |
|
La sécurité apporte aux citoyens
la protection, leur assure les conditions de l'épanouissement
auquel ils peuvent prétendre, et développe
au sein de la société un climat de confiance.
En revanche, elle ne peut être considérée
comme une fin en soi, ce qui exclut de l'assurer au détriment
des valeurs républicaines. Elle est indispensable
au projet de société mais ne peut prétendre
lui donner son sens profond.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Quand la sécurité n'est plus globale un exemple : la structuration du territoire |
|
L'histoire de l'urbain a connu, à
toutes les époques, la problématique de
l'insécurité. La ségrégation
urbaine, vieille comme la ville, s'organise désormais,
en partie, à partir de préoccupations sécuritaires,
au détriment, dans certains cas, d'une vision globale
de la sécurité. Trois exemples illustrent
ce propos.
· Les résidences sécurisées,
nées aux Etats-Unis, font leur apparition en Europe.
Le " concept " est simple : un promoteur privé
garantit aux habitants une sécurité totale(à
ne pas confondre avec globale). La résidence est
isolée par des barrières ou murs difficilement
franchissables. On n'entre que sur invitation, dûment
badgée, après le passage d'une barrière
gardée par des vigiles armés et assistés
de chiens. Un système de vidéosurveillance
permet d'observer les alentours et l'intérieur
de la résidence. Des rondes ont lieu régulièrement.
Les habitants de ces îlots se caractérisent
par un très fort pouvoir d'achat . La ségrégation
sociale est ici poussée à son sommet. C'est
à notre sens la négation de la notion de
sécurité globale.
· La favela sécurisée
Rocinha, l'une des plus importantes favelas de Rio de
Janeiro, située sur un morne d'accès déjà
difficile, s'est dotée de barrières et de
caméras de surveillance à ses points d'entrée
, pour repérer…l'arrivée de la police.
Celle-ci troublerait l'ordre imposé par les narcotrafiquants
qui contrôlent la favela. Ces derniers fournissent
par ailleurs dispensaires, écoles, petites installations
sportives, bref, les services publics de base que l'administration
n'assure plus. Les narcotrafiquants réalisent en
fait un judicieux placement et payent peu cher l'asservissement
des populations.
· La sécurité différenciée
Le trafic de stupéfiants a pris une ampleur certaine
à Paris. Voici quelques années, il était
présent dans certains quartiers caractérisés
par une forte densité de passage, liée à
une activité importante et touristique. Aujourd'hui,
le trafic a disparu, ou presque, aux Champs Elysées,
au Quartier Latin, il est devenu envahissant dans d'autres
quartiers, plus périphériques, moins protégés.
La police, efficace dans le premier cas, s'avoue impuissante
dans les seconds. Où est la sécurité
globale ?
Ces exemples démontrent que les perceptions
sectorielles débouchent sur une sécurité
à deux vitesses , en contradiction avec la vision
globale de la sécurité de la société.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| La culture de sécurité |
|
| L' ensemble des citoyens est concerné
par la sécurité. Chacun doit connaître,
comprendre ce dont il s'agit et mesurer sa responsabilité
dans ce domaine. La société doit donner
à tous une véritable culture de sécurité. |
| retour en haut de page |
 |
|
| L'initiation |
|
Cette culture commence par une initiation
confiée de fait à la famille et à
l'Education Nationale. Le rôle de ces deux instances
est d'éclairer l'individu, dès son plus
jeune âge, sur la multiplicité et la diversité
des risques et menaces qu'il pourra connaître lui-même.
Ainsi les enfants, dès l'école maternelle,
apprennent à respecter l'autre : camarade, instituteur
ou animateur ainsi que le règlement des établissements
dans lesquels ils passeront souvent 6 à 8 h par
jour pendant de longues années. Ils doivent par
ailleurs être éveillés à leur
responsabilité et instruits de l'importance de
la sécurité, importance qui s'imposera tout
au long de l'existence. Cette sensibilisation initiale
participe donc à l'acquisition par l'individu de
sa propre maturité, puisqu'elle lui permet d'avoir
une approche raisonnée de la réalité.
A ce titre, elle est un élément central
de l'éducation.
Mais même si on sait qu'une situation est dangereuse
et comment, par exemple, on évacue une école
en cas d'incendie ou comment traverser une rue, on ne
peut pas, par définition, apprendre à faire
face à toutes les situations.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| La formation |
|
C'est pourquoi l'initiation doit se prolonger
à l'âge adulte par une formation continue
de sécurité adaptée à chaque
étape de la vie professionnelle et personnelle,
et ce avec d'autant plus d'attention que les fonctions
assumées impliquent un plus grand nombre de personnes
. La conduite des véhicules comme l'occupation
d'un emploi dans une usine à risque nécessitent
une formation spécifique qu'il faudra actualiser
en fonction de l'évolution des techniques et du
contexte.
Le rôle de la formation est de permettre de faire
face à tous les dangers pouvant survenir dans les
occupations professionnelles, associatives ou personnelles.
C'est donc une activité plus opératoire
: il n'est question que d'étudier l'action qui
permet une sécurité, à travers des
règles et des organisations particulières.
L'importance de la sécurité et le fait que
l'individu y ait son rôle sont des évidences,
si l'initiation a été correctement faite.
Mais entre l'initiation et la formation, il y a un vaste
domaine dans lequel ni l'école, ni les parents,
ni les consignes de sécurité d'une entreprise
n'ont d'influence. Il faut par exemple, non seulement
connaître l'attitude à adopter dans le cas
d'un accident nucléaire, mais il faut d'abord savoir
s'il y en a un.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'information |
|
Ce genre de danger concerne toutes les
composantes d'une société. Les caractéristiques
d'un danger et les règles de sécurité
s'y rapportant doivent être communiquées
à tous les membres de la collectivité de
sorte que personne ne voie sa situation particulière
le rendre plus vulnérable. Ainsi, pour des raisons
de santé publique, la loi oblige tous les enfants
à être vaccinés, quand bien même
les autorités religieuses que leurs parents reconnaissent
s'y opposeraient. Le respect de la diversité des
cultures ne doit pas se traduire par un manque de respect
de l'individu.
Nous appelons le fait de faire connaître en permanence
les risques face auxquels il convient de se prémunir,
les règles de conduite, dans tous les domaines
et pour tous : l'information de sécurité.
L'information répond donc à la généralité
du danger pour l'ensemble de la société.
L'information est une condition de l'exercice démocratique
et républicain de la sécurité. Par
une information concrète, précise et complète,
le citoyen sait qu'on ne sait pas à sa place. Non
seulement il est mis face à ses responsabilités
immédiates, mais, fort d'une maturité acquise
au cours de l'éducation, il est incité à
nourrir une réflexion à la fois conjointe
et individuelle sur la sécurité. C'est pourquoi
les autorités ne doivent pas cacher les résultats
des tentatives des services compétents pour réduire
l'insécurité. Le fait de ne pas publier
le rapport d'évaluation des Contrats Locaux de
Sécurité priverait le citoyen de l'exercice
légitime de sa participation à la vie de
la cité. Ne sachant pas s'il est bien protégé,
il ne peut délibérer en toute conscience
des modifications à apporter, pas plus qu'il ne
sait s'il doit s'en remettre aux autorités ou se
charger lui-même de sa sécurité. L'opacité
crée une situation contradictoire. D'un coté
on dit au citoyen qu'il a une part de responsabilité
; de l'autre on le prive d'une juste évaluation
de ce rôle, ne pouvant lui éviter une lecture
subjective de la réalité et le double écueil
d'une surestimation ou d'une sous-estimation de cette
réalité.
L'exhaustivité de l'information se heurte à
la partialité des points de vue et à la
subjectivité des perceptions. Ce constat pose la
question de la pratique de l'idéal démocratique
et du rapport entre la sécurité et la liberté.
Il s'agit de savoir si le meilleur moyen d'assurer la
sécurité réside dans des consignes
que les citoyens seraient impérativement tenus
de suivre . En fait, tout individu peut recevoir une information
objective et participer au débat public sur la
sécurité.
Ainsi, la liberté et la sécurité
ne connaissent pas de tension si la liberté est
conçue comme action rationnelle, ce qui oblige
chaque mesure de sécurité à l'être,
et chaque individu à se conduire comme législateur
, car être libre, c'est obéir à la
loi qu'on s'est fixée .
Cette perception de soi-même comme législateur
ne peut se faire que si l'éducation de l'enfant
est orientée vers l'acquisition d'une réflexion
rationnelle. Une telle éducation permet à
l'individu de se transformer en personne, et de faire
de l'intérêt de chacun son intérêt
propre. C'est donc une éducation universaliste.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'apprentissage |
|
| L'initiation, la formation et l'information
se conjuguent pour déterminer une attitude face
aux risques et menaces et construire un référentiel
commun permettant l'acquisition de réflexes pour
réagir aux situations imprévues. C'est pourquoi
on retrouve, dans toutes ces étapes d'éducation
à la sécurité, des exercices de simulation
que nous regroupons sous la notion d'apprentissage de
la sécurité. Ces exercices ont pour objectif
de mettre en situation les acteurs, les usagers et les
équipes de secours, pour assimiler les consignes
à tenir en cas d'accident, comprendre les messages
et acquérir des attitudes réflexes permettant
de gagner du temps dans les interventions, de préserver
les vies, les installations et les biens. |
| retour en haut de page |
 |
|
| La valorisation de l'image |
|
Il paraît important de souligner
que la culture de sécurité implique une
valorisation de l'image de la fonction de ceux qui s'y
consacrent. Il n'est pas possible de prétendre
veiller à la sécurité tout en la
dédaignant. Insulter et mépriser celui par
qui on est gardé ou traiter avec désinvolture
les questions de sécurité, c'est se déconsidérer
et favoriser les incivilités. Ainsi, l'égard
que nous portons à nos enseignants, nos pompiers
ou nos policiers est révélateur de la valeur
que nous accordons à la sécurité.
Honorer ceux qui nous protègent, c'est reconnaître
notre vocation à nous garder nous-mêmes.
Il convient qu'en retour les gardiens de la cité
soient irréprochables, et que leurs manquements
éventuels soient reconnus et sanctionnés.
On ne peut exiger du citoyen le respect d'une loi que
ceux qui l'édictent ou qui en surveillent l'exécution
se dispenseraient d'appliquer. L'importance de la sécurité
et la considération dont elle doit faire l'objet
impliquent donc l'égale obéissance de tous
à la loi, et que la loi soit la même pour
tous.
Mais le législateur doit éviter de voter
des décisions qui se révèlent inapplicables
parce qu'elles n'ont pas été assorties de
l'attribution des moyens correspondants. Inapplicable,
la loi devient absurde et remet en question le principe
même de l'autorité qui lui est attaché.
Une loi votée sans souci de son application entraîne
la perte de confiance dans les élus du peuple,
dans le droit et entre les hommes. Alors, plus rien ne
garantit la sécurité de la personne face
aux appétits d'autrui, des corporatismes, des communautarismes
et des groupes de pression de toutes sortes.
Il résulte de ces constatations qu'une culture
de sécurité ne peut faire l'économie
d'aucun des éléments que nous avons cités.
Nous avons pu décomposer l'apprentissage de la
sécurité en trois étapes, dont aucune
n'a de sens sans la suivante. L'initiation ne concerne
que le monde de l'enfant et reste silencieuse quant aux
activités de l'adulte (en tenant évidemment
compte du fait que certaines règles de sécurité
sont valables tout au long de l'existence). La vie d'adulte
ne se restreint pas à ces seules activités
et l'information recouvre le vaste domaine de ce qui n'est
contenu ni dans l'initiation, ni dans la formation. Inversement,
il apparaît que chaque étape nécessite
l'étape précédente. La formation
ne peut exister sans une sensibilisation qui fait prendre
conscience à l'individu de l'importance de la sécurité
et des attitudes qui permettent de l'assurer. L'information
s'adresse à des consciences rationnelles, susceptibles
de comprendre la sécurité dans un monde
d'adulte, et de raisonner selon une perspective politique
: elle élargit la conscience de la personne au-delà
du champ de ses activités.
C'est cette perspective politique qui fonde la culture
de sécurité et qui assure la compatibilité
entre la sécurité et la liberté.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| La prise en compte de la sécurité |
|
La prise en compte de la sécurité
inclut l' analyse et la pratique. Elle repose sur l'enchaînement
de trois étapes :
- l'étude approfondie des risques et des menaces,
- le choix et la mise en oeuvre des réponses à
apporter aux problèmes posés
- l'évaluation des résultats.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'ETUDE |
|
Elle a pour objet l'identification de tous
les éléments caractérisant les problèmes
posés et la détermination des solutions
les mieux adaptées pour y répondre.
Identifier c'est définir les risques à l'aide
d'un modèle de référence : analyser,
classer les éléments d'informations qui
nous parviennent avec les repères dont nous disposons
pour discerner les priorités et construire notre
propre modèle en vue de la prise de décision.
Ces repères individuels ou collectifs sont le produit
de l'expérience et des valeurs, elles-mêmes
fondées sur le rapport entre l'individu et la société
à un moment donné, sur la culture, la capacité
à trouver et comprendre l'information, l'intégration
de l'individu et sa reconnaissance par la collectivité.
L'étude objective du risque concerne sa nature,
ses causes, ses effets, sa dynamique, sa perception par
les différents acteurs ainsi que la détermination
des réseaux impliqués. La complexité
et l'évolutivité de ces paramètres
imposent qu'elle fasse l'objet d' un suivi permanent et
qu'elle soit conduite à deux niveaux d'expertise
complémentaires, le niveau technique incombant
aux spécialistes des domaines concernés,
puis le niveau stratégique fondé sur une
approche globale donc nécessairement pluridisciplinaire.
Le souci de sécurité découle de l'existence
de risques. Pour garantir une action efficace, il faut
procéder à l'analyse systémique du
danger en présence duquel on se trouve. Cette étude
ne peut s'effectuer sans intégration des contraintes
de temps, d'espace et de coût. En effet, se combinent
plusieurs référents de temps: le temps de
réaction à l'événement, le
temps de mise en place des dispositifs, le temps pédagogique
(évolution des mentalités), le temps de
socialisation (harmonisation des rythmes de vie individuels
et collectifs qui permet l'intégration sociale),
le temps politique qui tend à privilégier
la durée du mandat électif comme horizon
décisionnel. Ces temps doivent s'accorder avec
le temps de gestation des risques et menaces, qui peut
aller de l'instantanéité (catastrophes naturelles)
à des temps très longs (risques environnementaux),
en passant par des temps relativement longs (géostratégie).
A la diversité des temps correspond une diversité
de l'espace à prendre en considération,
qu'il s'agisse de l'espace géographique (local,
régional et international) ou du champ des domaines
concernés (santé, environnement, ordre public,…)
; ces espaces sont structurés par des flux spécifiques
nécessitant une représentation cartographique
évolutive. Enfin, la sécurité a un
coût. Celui-ci est d'autant plus lourd que les risques
n'ont pas été suffisamment anticipés
et maîtrisés, que les exigences des citoyens
sont plus élevées. L'ensemble de ces contraintes
conduit à définir des priorités,
ainsi que des seuils d'acceptabilité.
Afin d' éclairer au mieux le choix politique, l'étude
devra reconnaître l'importance de l'anticipation,
de l'analyse des retours d'expériences et de la
hiérarchisation des risques.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'anticipation |
|
Chacun sait que l'imprévoyance coûte
cher, et que les réactions trop tardives ne concernent
que les effets immédiats sans s'attaquer aux problèmes
de fond.
Plus tôt on s'intéresse à l'émergence
d'un risque, plus il sera facile de le conjurer, d'y parer
efficacement, et de minimiser les dommages qu'on peut
en craindre.
Il est donc nécessaire de s'attacher à un
effort d'anticipation global et permanent.
Cet effort porte sur l'analyse du développement
possible des situations d'insécurité existantes
et la prise en compte des risques potentiels. Il doit
aussi s'appliquer à l'exploration de risques imaginables
par une recherche d'indices annonciateurs de dysfonctionnements
lourds de conséquences.
L'anticipation requiert la mobilisation des responsables
: elle constitue une démarche de prévention
et contribue à la maîtrise nécessaire
à une politique de sécurité efficace.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'expérience |
|
La sécurité est d'autant
plus difficile à appréhender qu'elle s'applique
à des domaines complexes, caractérisés
par l'incertitude et l'imprévisibilité.
L'étude des retours d'expériences contribue
à la connaissance du problème, par l'analyse
de l'état des lieux. Elle transforme la vue linéaire
individuelle d'un phénomène en une mise
en perspective des perceptions des acteurs. Ainsi, il
est possible d' imaginer les évolutions possibles,
de comprendre les réactions des organisations et
des individus ( les délais de latence) et d' examiner
dans quelle mesure les réponses apportées
aux situations vécues sont transposables. En outre,
ces retours d'expériences permettent le montage
d'exercices nécessaires à l'apprentissage
et l'élaboration de scénarii et de stratégies.
Aucune situation d'insécurité n'étant
intégralement reproductible, l'exploitation des
expériences demande discernement et savoir-faire.
En effet, toute solution pertinente à une situation
dépend étroitement d'un contexte politique,
social et économique, de la perception et des comportements
des acteurs individuels et collectifs.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| La hiérarchisation |
|
La complexité de l'appréhension
et du traitement de la sécurité conduit
à recenser la diversité des causes et des
conséquences des problèmes d'insécurité
et à les classer en fonction de leur importance
et de leur probabilité d'occurrence (la courbe
de Farmer décrit l'importance des risques en fonction
de leur gravité et de leur probabilité d'occurrence)
pour construire la matrice d'efficacité des solutions
envisageables dans le temps et dans l'espace. Il importe
de hiérarchiser les causes en fonction de leur
caractère déterminant dans le développement
de l'insécurité et les conséquences
selon leur caractère de gravité, tout en
discernant les interactions et les phénomènes
d'engrenage dont les unes et les autres peuvent faire
l'objet.
L'élaboration des choix stratégiques associe
à un niveau d'efficacité escompté,
un processus caractérisé par des coûts
et des délais.
La matrice d'efficacité représente l'éventail
des solutions possibles et permet de les hiérarchiser.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Les obstacles à surmonter |
|
Les principaux obstacles à surmonter
tiennent essentiellement aux organisations et à
leur fonctionnement .
L'organisation peut générer des dysfonctionnements
dus à la répartition des attributions entre
les divers organismes concernés. Cette répartition
peut comporter des lacunes, auquel cas certains problèmes
ne sont pas pris en considération. Elle peut aussi
se prêter à des redondances d'attribution
: un même problème de sécurité
peut alors être pris en charge par deux organismes
différents et provoquer un éventuel conflit
de prérogatives générateur de perte
de temps et d'efficacité.
Le cloisonnement des organisations ne favorise pas la
transversalité nécessaire au bon déroulement
de l'étude et à son efficacité. Cette
transversalité implique la reconnaissance des compétences
et une transmission aisée des informations indispensables
.
Enfin les responsables de l'étude ne doivent pas
être soumis à des contraintes susceptibles
de nuire à la qualité des résultats,
ils doivent donc disposer de l'indépendance ainsi
que des moyens et des délais requis.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| LA DECISION et SA MISE EN OEUVRE |
|
La décision apporte une réponse
à un problème d'insécurité
posé. Elle se caractérise par des objectifs,
une stratégie et des moyens.
L'éventail des solutions possibles que la matrice
d'efficacité a permis de classer se trouve confronté
à un ensemble de contraintes conjoncturelles et
structurelles qui rend difficile le choix qui incombe
au responsable politique. Sa démarche consiste
à privilégier certains objectifs considérés
comme prioritaires et à accepter en contrepartie
de réduire ou de différer l'effort souhaitable
sur d'autres objectifs.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Des objectifs, une stratégie, des moyens |
|
Quels qu'ils soient, les choix d'objectifs
et de stratégie effectués doivent s'insérer
dans une vision globale et prospective, et constituer
des solutions ouvertes pour éviter l'enfermement
contre-productif du traitement partiel d'un problème
artificiellement déconnecté de son contexte.
L'application des décisions implique la réunion
et la mise en œuvre de moyens humains , matériels
et financiers clairement identifiés.
Il s'agit généralement de moyens existants
qu'il convient de mobiliser pour une action nouvelle.
Ceci impose, en particulier pour les moyens humains, une
souplesse de gestion des personnels qui ne soit pas entravée
par des rigidités liées à des statuts
favorisant l'immobilisme ou le corporatisme.
Face à des situations exceptionnelles (catastrophes,
terrorisme…), le pouvoir politique doit pouvoir recourir
à des moyens exceptionnels constitués par
des réserves notamment des armées dont il
importe de prévoir la constitution et les modalités
d'engagement.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Des principes d'actions |
|
Le succès d'une politique repose
sur un partage cohérent des responsabilités,
sur la coordination et sur le suivi des actions engagées.
Les stratégies envisagées nécessitent
la participation d'acteurs différents que leurs
attributions normales ne prédisposent pas , en
général, à travailler ensemble et
qui devront nouer entre eux des relations de travail nouvelles
et particulières ( exemple : justice-éducation
nationale, santé-agriculture,…).
Il importe alors de s'attacher dès le départ
à une clarification des responsabilités
avec notamment la désignation d'une autorité
pilote d'ensemble, chargée d'atteindre l'objectif
fixé par le pouvoir politique. Ce responsable devra
nécessairement avoir autorité sur les différentes
parties prenantes pour ce qui concerne son domaine de
compétences.
Ainsi , la formule d'un ministère de la sécurité,
n'ayant pas en ce domaine autorité sur les autres
ministères, paraît devoir être rejetée
car elle s'opposerait à la transversalité
indispensable au recueil d'informations et à la
conduite de l'action. Elle aurait aussi l'inconvénient
de favoriser le désintérêt des autres
ministères pour la sécurité et de
porter en germe le risque d'une dérive vers un
ministère de la sûreté.
Le deuxième principe impose la coordination des
actions . La multiplicité des acteurs, les différences
de statut, de méthodes, d'habitudes, risquent de
conduire à la dispersion des efforts, à
un gaspillage d'énergie et de moyens. Les responsables
de tous niveaux doivent donc s'attacher à assurer
la convergence des efforts par une concertation régulière
entre les différents acteurs oeuvrant sur un même
créneau. Il importe notamment de bien coordonner
les actions du monde associatif et celles des institutions
de façon à en obtenir une judicieuse complémentarité.
Enfin, le suivi des actions entreprises est fondamental.
Dans un domaine aussi complexe que la sécurité,
les solutions fondées sur une étude théorique,
aussi poussée soit-elle, ne peuvent prétendre
à la perfection, d'autant que le contexte de leur
mise en application ( contexte politique, humain, économique,
) peut facilement influer sur les résultats escomptés.
Aussi est-il nécessaire de procéder à
un suivi rigoureux de la mise en œuvre des décisions,
à une analyse régulière des écarts
entre les résultats constatés et les résultats
prévus, de façon à pouvoir sans retard,
réagir avec efficacité, surmonter les obstacles
imprévus, pallier les déficiences ou infléchir
les orientations initiales.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'évaluation des résultats |
|
Une prise en compte optimale de la sécurité
impose une évaluation des résultats des
actions entreprises. Cette phase indispensable est souvent
minimisée par l'action politique friande des effets
d'annonce mais peu empressée à mesurer l'impact
réel , quantitatif et qualitatif, des décisions
prises. Ainsi les politiques de la ville qui se sont succédé
auraient été plus performantes si chacune
avait pu bénéficier des retours d'expériences
des précédentes.
L'évaluation est nécessaire à chaque
étape significative de l'action entreprise et lorsqu'elle
est arrivée au terme qui lui a été
fixé.
La mesure de l'écart entre la prévision
et la réalité constitue une information
majeure :
-comme appréciation du degré d'atteinte
de l'objectif visé et des conditions dans lesquelles
les résultats ont été obtenus(coûts,
délais, champ d'application).
-comme retour d'expériences pour les décisions
futures à partir de l'analyse critique des choix
faits, de l'attitude des acteurs, de l'influence du
contexte connu et des éléments imprévus,
-comme facteur d'une éventuelle remise en cause
des normes, des méthodes et des organisations.
Ainsi, les problèmes rencontrés à
l'occasion du naufrage de l'Erika auraient été
mieux maîtrisés si tous les enseignements
avaient été tirés de la gestion
de celui de l'Amoco-Cadiz.
Pour être crédible, l' évaluation
doit être rigoureuse et exhaustive ; elle ne peut
se limiter à des impressions générales
ni à un bilan incomplet et subjectif. Elle doit
être conduite par un ou des organismes indépendants
dont les conclusions seront rendues publiques, ce qui
exclut la pratique des rapports non diffusés
par souci de dissimuler des résultats non satisfaisants.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Propositions |
|
La nouvelle approche de la sécurité
retenue dans la présente étude conduit à
énoncer un certain nombre de propositions de nature
à assurer une meilleure maîtrise du phénomène,
dans les deux domaines suivants: la culture de sécurité
et l'amélioration de sa prise en compte.
En outre sont proposés en annexe les outils nécessaires
à la mise en œuvre d'une politique globale
de sécurité.
|
| retour en haut de page |
 |
|
|
|
| Apprentissage de la sécurité |
|
Intégrer dans les enseignements
existants, généraux et techniques, primaire
et secondaire, un apprentissage de la sécurité.
Le programme envisagé aura pour principal objet
de faire prendre conscience à chacun de sa responsabilité
dans la lutte contre l'insécurité. Il devra
être progressif, se fonder sur des cas concrets
et comporter des exercices pratiques pluridisciplinaires
pour accroître les capacités d'analyse de
la complexité. La formation initiale aura pour
finalité d' élargir les modèles de
représentation individuelle pour intégrer
la notion d'intérêt collectif .
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Formation à la sécurité |
|
- Inclure dans tout cursus de formation
initiale et continue, notamment dans ceux préparant
à des postes de responsabilité (université,
institut, grandes écoles, stages spécifiques..)
des modules de sensibilisation et de mises en situation
pour acquérir les réflexes permettant aux
intéressés d' assumer leurs responsabilités
.
- Créer un métier : le concepteur de sécurité
globale .
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Valorisation de la sécurité |
|
- Développer la sensibilisation
de l'opinion par une communication s'attachant à
éclairer le citoyen sur la réalité
des situations, expliquer et justifier les choix opérationnels
.
- Accroître dans l'esprit de la population l'importance
de la sécurité et valoriser la mission de
tous ceux qui en ont la charge.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'amélioration de la prise en compte de la sécurité |
|
| Cette amélioration concerne les
domaines de la méthodologie, de l'organisation
et des comportements. |
| retour en haut de page |
 |
|
| La méthodologie : 3 phases |
|
Il n'est pas satisfaisant de se limiter
à la résolution au cas par cas des problèmes
d'insécurité, au fur et à mesure
de leur apparition. Sans minimiser l'importance évidente
des réactions ponctuelles et à effet de
court terme, il convient de s'attacher à traiter
les problèmes au fond, dans leur contexte et en
référence aux objectifs d'une politique
globale de sécurité.
L'approche globale préconisée respectera
une séquence logique en trois phases :
-la phase d'étude conduit à l'élaboration
de propositions,
-la phase de l'action, qui met en oeuvre la décision,
ne se conçoit qu'assortie d'un suivi rigoureux
comportant l'audition des acteurs de la sécurité
globale et l'analyse permanente des renseignements consignés
dans les tableaux de bord,
-la phase d'évaluation , condition essentielle
de progrès, permet d'apprécier l'efficacité
des actions engagées et d'envisager les suites
à leur donner(modifications à apporter aux
normes, aux organisations, sanctions à prononcer,
….).
|
| retour en haut de page |
 |
|
| L'organisation |
|
L'application de l'approche globale de
la sécurité suppose qu'auprès du
responsable de tout
ensemble fonctionnel soit mise en place une structure
en charge de la sécurité.
Au niveau de l'Etat, une Organisation en charge de la
Sécurité Globale devra être créée
avec pour missions l'analyse globale des problèmes,
l'élaboration de propositions de politique générale,
la supervision des actions, l'évaluation des résultats
et , en situation exceptionnelle, un soutien éclairé
du pouvoir politique.
Cette organisation devra être placée sous
la responsabilité du 1er ministre et avoir autorité
, dans son seul domaine de compétences, sur les
différents départements ministériels.
Son bon fonctionnement suppose l'indépendance (à
l'abri des courants politiques ou autres lobbies), la
continuité ( non tributaire du temps politique)
et la réunion de compétences pluridisciplinaires
incontestables. Pour renforcer sa légitimité
et sa crédibilité, elle devra s'appuyer
sur les travaux de la Commission Nationale de Déontologie
de la Sécurité.
Face à des situations exceptionnelles (catastrophes,
terrorisme,…), cette organisation sera en mesure
de proposer dans les meilleurs délais des réponses
appropriées comportant la désignation d'une
autorité pilote, la définition des dispositifs,
des moyens et des modalités juridiques (éventuellement
dérogatoires) de leur mise en œuvre.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Les comportements |
|
| Le pouvoir politique privilégiera
notamment :
- une nouvelle conception de la gestion des ressources
humaines de la fonction publique qui apportera la souplesse
indispensable à l'efficacité du traitement
de l'insécurité : disponibilité
et mobilité ,
- l'ouverture d'esprit qui favorise les relations transverses,
évite le cloisonnement et la rétention
d'informations,
- la rigueur dans les analyses et les évaluations,
- la transparence, exigence de la démocratie
et condition de la confiance indispensable au climat
de sécurité.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Conclusion |
|
| L'insécurité est devenue
la première préoccupation de nos concitoyens,
le problème majeur de notre société.
Elle s'exprime de multiples façons: les catastrophes
de toute nature, les débordements de la violence,
le développement de l'incivisme et de la délinquance,
l'aggravation des inégalités, de la pauvreté
et de la précarité, l'accentuation des déséquilibres
démographiques, économiques et sociaux,
la montée des communautarismes intolérants,
la toute puissance de l'argent alimentant les réseaux
maffieux et la criminalité internationale.
Depuis longtemps, ces phénomènes funestes
ont suscité des réactions vigoureuses
et de plus en plus nombreuses de la part des citoyens,
des associations et des institutions. Leur lutte s'est
engagée essentiellement là où l'insécurité
se fait directement sentir, sur le terrain, au plus
près des victimes effectives ou potentielles
et elle y a atteint des résultats souvent remarquables.
Mais, pour primordial qu'il soit, le combat du terrain
n'est pas suffisant ; il se heurte en effet à
divers obstacles qui en limitent l'efficacité
: le défaut de vision d'ensemble d'un domaine
par nature complexe, une certaine dispersion des efforts,
l'impératif d'urgence qui s'attache plus au traitement
des effets qu'à celui des causes et enfin les
contraintes liées au manque de moyens et à
la relative rigidité de règles juridiques
et administratives parfois inadaptées.
L'engagement de terrain doit donc se conjuguer avec
une approche " par le haut ", par une politique
globale de sécurité, dont nous avons tenté
d'esquisser les grandes lignes. Nous nous sommes attachés
à définir un concept de sécurité
globale et à formuler des propositions concrètes.
Celles-ci ne demandent pas un effort financier supplémentaire
mais une nouvelle organisation permettant une mise en
réseau efficace des ressources existantes.
Nous considérons que l' adoption de ces propositions
et leur mise en œuvre avec détermination
et pragmatisme constitueront un pas nouveau et important
dans le processus d'amélioration de la sécurité
dans notre pays.
Le progrès escompté, qui se fonde en
grande partie sur les fonctions régaliennes de
l'Etat et l'efficacité que l'on peut en attendre,
doit se prolonger par la nécessaire prise en
considération de la dimension internationale
de nombreux problèmes d'insécurité.
Cette phase est déjà engagée et
doit être poursuivie avec ténacité,
même si son cheminement risque d'être long
et difficile en raison des divergences qui entravent
l'action de la communauté internationale.
Si la sécurité occupe une place majeure
dans les préoccupations du moment, il faut raison
garder et ne pas se laisser gagner par un alarmisme
excessif. Les risques sont inhérents à
la condition humaine; certains sont ferments d'épanouissement,
d'autres, dommageables, doivent néanmoins être
considérés comme acceptables, d'autres
enfin doivent faire l'objet d'une lutte sans merci,
et ce sont ces derniers qui nous intéressent
ici.
Enfin, il convient d'éviter d'une part des visions
simplistes et sans nuances illustrées par les
slogans démagogiques et fallacieux du type "
risque zéro ", " tolérance zéro
" ou " impunité zéro "
et d'autre part l'obsession sécuritaire qui pourrait
conduire à sacrifier à la sécurité
les valeurs premières de liberté, de justice
et de solidarité.
|
| retour en haut de page |
 |
|
| Annexe : les outils de la sécurité globale |
|
| La mise en place d'une politique de sécurité
globale implique de :
1. Constituer des bases de données cohérentes
utilisables par tous les acteurs.
2. Définir des concepts simples et des échelles
de gravité permettant des sommations, des comparaisons
dans l'espace et dans le temps.
3. Construire la carte décisionnelle qui permet
d'identifier le réseau des acteurs, les niveaux
d'organisation, l'espace concerné par les décisions
, le système global de communication de l'organisation.
4. Comprendre le référentiel des autres,
reconnaître leurs capacités et leurs limites
pour construire des réseaux actifs et efficaces.
5. Mobiliser tous les acteurs par l'analyse des retours
d'expériences pour développer le sens
critique, la responsabilité, l'autonomie, constituer
une mémoire collective et un instrument de projection
à moyen et long terme.
6. Concevoir la communication comme un outil de mise
en cohérence des différents référentiels,
de transmission de l'information , d'explication des
décisions et d'évaluation de la situation.
7. Produire la matrice d'efficacité qui permet
d'évaluer la fiabilité et la pertinence
des dispositifs, d'analyser la complexité des
organisations et d'accroître l' efficacité
des actions en situation normale et en situation dégradée.
8. Bâtir, entretenir et surveiller un réseau
d'acteurs chargés de l'information, de l'anticipation
et de la mise en œuvre de la décision.
9. Construire des indices de sécurité
(10 environ) permettant d' appréhender rapidement
la sécurité globale comme une construction
positive de notre démocratie : gains de temps,
de qualité, réduction des coûts
…
Passer de la destruction à la construction de
valeur, en décelant les éléments
constitutifs de la chaîne de la Sécurité
: ce qui implique une analyse de la qualité des
espaces , des réseaux, de la communication, de
la santé publique(E.S.B.)
Rechercher les critères de mise en confiance
des citoyens.
10. Formaliser un compte satellite " Sécurité
Globale "
Extension du cadre central des comptes nationaux permettant
d'analyser de manière horizontale les domaines
et les enjeux de la collectivité nationale à
l'instar de celui de l'éducation nationale, du
logement et de la défense.
Ce compte permettrait pour la comptabilité nationale
une analyse économique transversale des dépenses
et du coût de la sécurité globale
en France.
Elaboré avec l'Institut des Hautes Etudes de
la Sécurité Intérieure, en associant
les différents bureaux statistiques concernés
: Intérieur, Collectivités locales, Justice,
Finances et Défense, il devra aussi recueillir
les informations auprès de l'INSEE concernant
les industries, les biens et services (assurances….).
|
| retour en haut de page |
 |
|
|
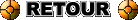
|
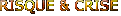
|
|